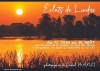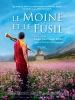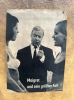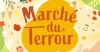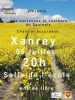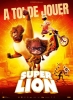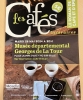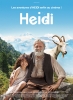Aujourd'hui : De l'Opéra au Palais Royal
Pensez à passer en mode plein écran et à activer le son
L'avenue de l'Opéra
C'est une voie radiale qui permet, en venant du quartier de la salle Garnier, de s'approcher du centre de Paris ou de traverser en direction de la rive gauche par le pont du Carrousel. Très fréquentée par les touristes, elle accueille notamment de nombreuses agences de voyages, des magasins de souvenirs et des banques. On peut lui rattacher le petit quartier japonais de la rue Sainte-Anne.
Un premier projet prévoit de créer une « avenue Napoléon » (en l'honneur de Napoléon III) depuis le Louvre jusqu'à l'endroit où la rue de la Paix rejoint les boulevards. Ce tracé fait l'objet d'un décret le 3 mai 1854, mais ne reçoit qu'un commencement d'exécution : les abords du Louvre sont dégagés dans le cadre du prolongement de la rue de Rivoli en direction du Châtelet.
Au début des années 1860, le projet de construction d'un nouvel opéra relance le projet de l'avenue par le décret du 24 août 1864, d'abord pour une largeur de 22 mètres3. Le chantier démarre à chaque extrémité, mais progresse lentement. La chute du Second Empire, en 1870, marque un coup d'arrêt des travaux, du moins pour quelque temps. L'« avenue Napoléon » est d'abord rebaptisée « avenue de la Nation », puis « avenue de l'Opéra » en 1873. Après le décret d'utilité publique du 27 juin 1876, les travaux reprennent et sont rapidement achevés, avec une largeur de 30 mètres.
Les terrains riverains sont vendus par la ville de Paris avec obligation pour les acquéreurs d'y édifier des bâtiments en se conformant aux plans de façades indiqués par l'administration municipale. Les derniers immeubles bordant cette nouvelle percée haussmannienne seront édifiés en 1879.
Dans les années 1950, l'avenue a été profondément transformée par l'élargissement de sa chaussée automobile, passée de 15 à 20 mètres de large, au détriment des trottoirs.
Camille Pissarro, installé au Grand Hôtel du Louvre entre 1897 et 1899, peint onze paysages montrant l'avenue de l'Opéra, la place du Théâtre-Français et l'entrée de la rue Saint-Honoré.
« J'oublie de t'annoncer que j'ai trouvé une chambre au Grand Hôtel du Louvre avec une vue superbe de l'avenue de l'Opéra et du coin de la place du Palais-Royal ! C'est très beau à faire ! Ce n'est peut-être pas très esthétique, mais je suis enchanté de pouvoir essayer de faire ces rues de Paris que l'on a l'habitude de dire laides, mais qui sont si argentées, si lumineuses et si vivantes. C'est tout différent des boulevards. C'est moderne en plein ! »
Boulevard des Italiens
Il fait partie de la chaîne des Grands Boulevards constituée, d'ouest en est, par les boulevards de la Madeleine, des Capucines, des Italiens, Montmartre, Poissonnière, Bonne-Nouvelle, Saint-Denis, Saint-Martin, du Temple, des Filles-du-Calvaire et Beaumarchais.
Il doit son nom au Théâtre-Italien occupé aujourd'hui par l'Opéra-Comique qui y fut construit en 1783.
Le boulevard a été créé après la suppression décidée en 1670 de l'enceinte de Louis XIII devenue obsolète, en avant du bastion 4 (« bastion de Gramont») de ce rempart, à travers des jardins maraichers. au début du XVIIIe siècle Il a été formé en vertu de lettres-patentes du mois de juillet 1676, sous le nom de « boulevard Neuf » avant de prendre le nom de « boulevard du Dépôt », jusqu'en 1783, en raison du dépôt du régiment des Gardes françaises construit en 1764 à l'angle de la rue de la Chaussée-d'Antin, par le colonel Louis Antoine de Gontaut-Biron en 1764.
L'espace entre le boulevard et l'ancien rempart qui était situé sur un tracé irrégulier entre l'angle de la rue de Richelieu et de l'actuelle rue Feydeau, ancienne rue des Fossés-Montmartre, et l'angle de la rue Louis-le-Grand et de l'avenue de l'Opéra, s'urbanisa à la fin du XVIIIe siècle au début du XVIIIe siècle, notamment avec la construction de plusieurs hôtels particuliers, notamment l'hôtel de Ménars, l'hôtel de Lorges, l'hôtel de Gramont, l'hôtel d'Antin, l'hôtel de Choiseul démolis à la fin du XVIIIe siècle ou au XIXe siècle dont les terrains ont été lotis avec percements de rues.
Appelé « boulevard Cerutti » sous la Révolution, du nom d’un hôtel du boulevard dans lequel s’était établi l'écrivain Joseph-Antoine Cerutti (1738-1792), il prit le nom, sous le Consulat et l'Empire, de « boulevard de la Comédie-Italienne » pour une partie et « boulevard d'Antin », ou « boulevard de la Chaussée d'Antin » pour l'autre partie.
Il fut également nommé « boulevard de Coblentz » ou « petit Coblence » sous le Directoire, parce que s'y rassemblaient les émigrés royalistes de retour au pays après un long séjour dans la ville allemande de Koblenz, puis de 1815 à 1828, « boulevard de Gand », sous la seconde Restauration, en souvenir de l'exil à Gand du roi Louis XVIII pendant les Cent-Jours, avant de prendre son nom actuel.
Tout au long du XIXe siècle, et jusqu'à la Grande Guerre de 1914-1918, le boulevard constitua le rendez-vous des élégantes et élégants parisiens ; il vit se succéder les Incroyables et les Merveilleuses sous le Directoire, les gandins (d'après le « boulevard de Gand ») à la Restauration, les dandys sous Louis-Philippe Ier, les « lions » et les « lionnes » sous le Second Empire. Honoré de Balzac décrit comment l'arpenter avec la même élégance que Chateaubriand dans Théorie de la démarche (1833).
C'était la grande époque du Café de Paris, du Café Tortoni (qui inspira la mode du Café Tortoni de Buenos Aires), du Café Frascati, du Café Anglais, de la Maison Dorée…
À la suite de l'achèvement du boulevard Haussmann dans les années 1920, ces établissements disparurent pour être remplacés par des établissements financiers et autres.
Rue du Quatre-Septembre
Cette voie a été baptisée en l'honneur de la date de la proclamation de la Troisième République le 4 septembre 1870. Elle emmêne à l'ancienne Bourse de Paris
Bourse de Paris
Le lieu historique qu'elle a longtemps occupé à Paris est le palais Brongniart mais il n'existe plus de bourse physique à Paris (seuls des bureaux Euronext sont présents dans le quartier d'affaires de La Défense, où se déroulent les introductions en bourse).
L'instauration du monopole de la banque de France découle de plusieurs faits :
la politique centralisatrice de Bonaparte, actionnaire, comme plusieurs de ses proches ;
la recherche de financement pour les armées ;
le souhait d'éliminer la concurrence, pour empêcher l'émission inflationniste de billets de banque et protéger la rentabilité des actions ;
enfin, la volonté de pouvoir procéder à des opérations de sauvetage des caisses de l'État.
La Banque de France
En 1811, la Banque de France installe son siège dans l'Hôtel de Toulouse, ancien hôtel particulier du Comte de Toulouse, Louis-Alexandre de Bourbon, rue de la Vrillière, dans le 1er arrondissement de Paris, l'accueil du public se faisant aujourd'hui au 31, rue Croix des Petits Champs. La Banque de France, établissement alors privé, réalisait en 1808 un bénéfice net de 6 millions et demi de francs.
La Banque de France en 1870 versa un dividende de 80 francs par action. En 1871, après le massacre de la commune de Paris, il passa à 300 francs.
C'est la première capitalisation de la Bourse de Paris pendant toute la seconde moitié du XIXe siècle, avec quatre banques parmi les six premières à la Belle Époque.
Nationalisée en 1945, indépendante du pouvoir politique depuis 1994, la Banque de France a perdu une part de son autonomie lorsque la politique monétaire de la zone euro a été confiée à la Banque centrale européenne (BCE). La Banque de France est membre du Système européen de banques centrales et son gouverneur siège au conseil des gouverneurs de la BCE.
Bibliotheque Nationale
Le site historique de la BnF (autrefois appelée « Bibliothèque nationale » avant la construction et le transfert des collections des Imprimés sur le site Tolbiac) occupe l'ensemble du quadrilatère Richelieu, délimité par les rues des Petits-Champs (au sud), Vivienne (à l'est), Colbert (au nord) et Richelieu (à l'ouest).
Les plus anciens éléments de cet ensemble sont d'une part l'Hôtel Tubeuf, élevé en 1635 pour Charles de Chevry, acheté en 1641 par Jacques Tubeuf, président à la Chambre des comptes, d'autre part les restes des bâtiments élevés pour Mazarin par les architectes Pierre Le Muet et François Mansart, à qui on doit les deux galeries Mazarine et Mansart33. Les bâtiments ont subi de nouveaux aménagements à partir des années 1720 sous la direction de Robert de Cotte et de l'abbé Bignon, notamment pour accueillir le Cabinet des Médailles de retour de Versailles. Les modifications ont été peu nombreuses de la deuxième moitié du XVIIIe siècle au milieu du XIXe siècle. Une autre phase de grands travaux reprend avec Henri Labrouste à partir de 1854 : ses principales réalisations sont l'aile avec façade monumentale rue de Richelieu, le bâtiment de la rue des Petits Champs comprenant la rotonde, l'actuelle entrée sur la cour d'honneur et surtout la vaste salle de lecture (dite depuis « salle Labrouste ») et le grand magasin central des ImprimésRichelieu 3. Le fronton du bâtiment principal est orné d'une sculpture de Charles Degeorge qui représente la Science servie par les géniesRichelieu 4.
À Labrouste succède Jean-Louis Pascal, qui reconstruit à partir de 1878 la façade nord de la cour d'honneur de Robert de Cotte, restaure la façade est ouvrant sur le salon d'honneur, construit les ailes des rues Colbert (1898) et Vivienne (1902-1906), enfin lance en 1897 le chantier de la salle ovale qui ne sera toutefois achevée qu'en 1932 et inaugurée en 1936Richelieu 5.
Par manque de place, la Bibliothèque nationale a dû s'étendre hors du quadrilatère Richelieu. Elle a ainsi occupé, à partir de 1974, une partie de la Galerie Colbert pour installer notamment les services du dépôt légal, mais ces locaux ont été abandonnés à l'INHA avec l'ouverture du site F.-MitterrandRichelieu 6. La BnF utilise encore un bâtiment au 2 rue Louvois, construit en 1964 par André Chatelin pour le département de la Musique.
Avant les travaux de rénovation du site dans les années 2010, le quadrilatère Richelieu comprenait trois espaces d'exposition : la galerie Mazarine, pour les expositions thématiques, la galerie de photographie (connue aussi comme galerie Mansart) et la crypte, pour de petites expositions. À la cible, la galerie Mazarine sera intégrée aux espaces muséaux de la bibliothèque, tandis que la galerie Mansart restera un lieu d'expositions temporaires
Les Passages couverts de Paris
De façon typique, les passages couverts de Paris forment des galeries percées au travers des immeubles ou construites en même temps qu'eux. Ces galeries sont couvertes par une verrière offrant un éclairage zénithal qui leur donne une lumière particulière.
La quasi-totalité des passages couverts se trouve sur la rive droite de la Seine, à l'intérieur des limites de Paris avant son extension de 1860, principalement près des Grands boulevards, c'est-à-dire dans les zones drainant la clientèle aisée à l'époque de leur construction1.
La plupart des passages couverts furent construits dans la première moitié du XIXe siècle, afin d'abriter une clientèle aisée des intempéries et de proposer le plus souvent un ensemble de commerces variés. Paris comptera jusqu'à une trentaine passages couverts dans les années 1850 et exportera le modèle vers plusieurs autres villes en France puis à l'étranger (le passage du Commerce, à Niort, sera ainsi le premier passage de ce type ouvert en province [1829], suivi par la galerie Bordelaise [1833] à Bordeaux, le passage Lemonnier à Liège [1839] et le passage Pommeraye [1840] à Nantes)2.
Les travaux d'Haussmann, qui ouvrent les quartiers en perçant de grandes avenues, et la concurrence des grands magasins conduiront à la disparition de la plupart des passages.
Liste des passages accessibles : https://fr.wikipedia.org/wiki/Passages_couverts_de_Paris
La rue Sainte-Anne : "Little Tokyo"
À cheval sur les 1er et 2ème arrondissements de Paris, la rue Sainte-Anne s’étend de la rue Saint-Augustin au nord au quartier de l’Opéra au sud. Connue aujourd’hui pour abriter de nombreux commerces relatifs à la culture japonaise (dont Vivre Le Japon !), cette petite rue parisienne a en réalité toujours été baignée dans "l’exotisme". Un exotisme à plusieurs facettes, qui a changé de visage selon les siècles.
Très discrète pendant des années, la rue change brutalement de visage au début du XXème siècle.
Quand les bains publics et les petits cafés ouverts jusque tard dans la nuit prennent d’assaut Sainte-Anne, et que l’image macabre de la rue disparaît au profit d’une image plus festive et sulfureuse.
Devenue alors le nouveau quartier gay de la capitale, la rue Sainte-Anne restera essentiellement fréquentée des homosexuels de la ville qui profitent des hammams pour faire des rencontres jusqu’au lendemain de la Première Guerre Mondiale. Une clientèle qui explosera d’ailleurs au milieu des années 1960, grâce aux mouvements de libération sexuelle et aux nombreuses fêtes que les intellectuels gays de Paris y organisent.
Ce n’est qu’en 1980 que la rue perd alors de son public, quand le quartier gay déménage dans le Marais et qu’un nouveau genre de clientèle apparaît aux portes des établissements : les premiers entrepreneurs issus de l’immigration japonaise.
La rue qu’on surnomme aujourd’hui "Little Tokyo" a commencé à être associée à la culture japonaise dès les années 1960, lorsque les premiers entrepreneurs de l’archipel s’installent dans le quartier.
La Comédie Française
La Comédie-Française ou Théâtre-Français (surnommé « le Français ») est une institution culturelle française fondée en 1680 et résidant depuis 1799 salle Richelieu au cœur du Palais-Royal dans le 1er arrondissement de Paris.
Établissement public à caractère industriel et commercial depuis 1995, c'est le seul théâtre national en France disposant d'une troupe permanente de comédiens, la Troupe des Comédiens-Français. Bien que mort depuis sept ans quand la troupe a été créée, Molière est considéré comme le « patron » de l'institution, surnommée la « Maison de Molière ». Le fauteuil dans lequel il entra en agonie lors d'une représentation du Malade imaginaire est toujours exposé au fond de la galerie des bustes, après le Foyer Public.
La devise de la Comédie-Française est, en latin, "Simul et singulis" (qui peut être traduite par "être ensemble et rester soi-même"). Son emblème est une ruche avec des abeilles, à l'image d'une institution foisonnante
Le Café-Brasserie Ragueneau
202 Rue Saint-Honoré, 75001 Paris
Cyprien Ragueneau avait grandi dans une famille de restaurateurs. Né en 1608 (mort en 1654), ce pâtissier-rôtisseur-traiteur était non seulement un orfèvre de la cuisine mais aussi un passionné de théâtre et de poésie qui écrivait lui-même pour le plaisir. Hasard du destin, le café restaurant Ragueneau se trouve à l’emplacement d’un ancien théâtre où Molière joua ses premières pièces !
Contemporain de l’auteur du Bourgeois Gentilhomme, Ragueneau rêva toujours de voir ses œuvres mises en scène. Il finit par rejoindre la troupe du célèbre auteur français… Mais c’est finalement derrière les fourneaux qu’il exerça ses talents !
La légende raconte que Cyrano de Bergerac raffolait des tartelettes Amandine inventées par Ragueneau… Savez-vous qu’il existe en réalité deux Cyrano ? Le premier était un écrivain baroque, esprit brillant et polémiste. Il a inspiré le second, héros de la célèbre pièce du même nom, écrite par Edmond Rostand au 19e siècle. Rostand fait d’ailleurs de Ragueneau l’un de ses personnages, qui apparaît à l’acte 2 pour déclamer la recette des fameuses tartelettes !
"Chez le pâtissier Ragueneau", dans Cyrano de Bergerac / Jean-Paul Rappeneau. -- 1990
Pensez à passer en mode plein écran et à activer le son
Pour en savoir plus sur Le Café-Brasserie Ragueneau cliquez sur le lien ci-dessous