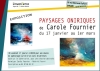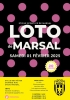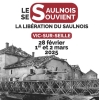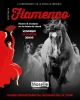En 1838. Léopoldine, qui a 14 ans, et Charles, qui en a 21, s’éprennent l’un de l’autre mais le père, très attaché à sa fille (qu'il surnomme Didine ou Didi), trouve celle-ci trop jeune (bien qu'elle soit l'aînée) pour pouvoir penser au mariage.
En 1838. Léopoldine, qui a 14 ans, et Charles, qui en a 21, s’éprennent l’un de l’autre mais le père, très attaché à sa fille (qu'il surnomme Didine ou Didi), trouve celle-ci trop jeune (bien qu'elle soit l'aînée) pour pouvoir penser au mariage.
Après avoir patienté cinq ans, Léopoldine épouse Charles Vacquerie, le 15 février 1843, en l'église Saint-Paul à Paris, dans la plus stricte intimité.
Le 2 septembre suivant, le couple arrive à Villequier. Le lundi matin, 4 septembre, vers dix heures, Charles Vacquerie embarque sur la Seine, en compagnie de son oncle, Pierre Vacquerie (1781-1843), ancien marin, et du fils de celui-ci, Arthur (1832-1843), âgé de onze ans, lauréat de la veille, pour se rendre chez Me Bazire, le notaire de Caudebec, à une demi-lieue de Villequier, où il avait affaire, dans un canot de course que son oncle venait de faire construire.
Au moment de partir, Charles demande à sa jeune femme si elle veut les accompagner. Celle-ci refuse parce qu’elle n’est pas habillée. Les trois voyageurs se mettent en route après avoir promis d’être de retour pour le déjeuner. Quelques instants plus tard, Charles revient prendre deux lourdes pierres en bas de la maison parce que le canot n’a pas assez de lest. Alors qu’il les met dans le bateau pour lui donner plus de solidité, sa jeune femme s’écrie : « Puisque vous voilà revenus, je vais aller avec vous ; attendez-moi cinq minutes ». On l’attend, elle monte dans le canot. Madame Vacquerie mère recommande de rentrer pour le déjeuner, regarde le canot s’en aller, et pense : « Il fait trop calme, ils ne pourront pas aller à la voile, nous déjeunerons trop tard ». En effet, la voile du canot retombe sur le mât. Pas une feuille ne tremble aux arbres. Cependant un léger souffle venant de temps en temps gonfler la voile, le bateau avance lentement et arrive à Caudebec, où ils se rendent chez le notaire auquel Charles allait parler pour des affaires relatives à la succession de son père, mort dernièrement.
À Caudebec, le notaire veut les persuader de ne pas s’en retourner par la rivière parce qu’il ne fait pas de vent et qu’ils feraient la route trop lentement. Il leur offre donc sa voiture pour les reconduire à Villequier. Les voyageurs refusent et reprennent leur canot.
L’oncle Vacquerie tient la barre du gouvernail, lorsque tout à coup entre deux collines, s’élève un tourbillon de vent2 qui, sans que rien ait pu le faire pressentir, s’abat sur la voile, et fait brusquement chavirer le canot. Des paysans, sur la rive opposée, voient Charles reparaître sur l’eau et crier, puis plonger et disparaître puis monter et crier encore, et replonger et disparaître six fois. Ils croient qu’il s’amuse alors qu’il plonge et tâche d’arracher sa femme, qui, sous l’eau, se cramponne désespérément au canot renversé. Charles est excellent nageur, mais Léopoldine s’accrochait comme le font les noyés, avec l’énergie du désespoir. Les efforts désespérés de Charles restent sans succès ; alors, voyant qu’il ne la ramènera pas avec lui dans la vie, ne voulant pas être sauvé, il plonge une dernière fois et reste avec elle dans la mort. Pendant ce temps, Madame Vacquerie, attend dans le jardin. Elle a pris une longue-vue et regarde dans la direction de Caudebec. Ses yeux se troublent, elle appelle un pilote et lui dit : « Regardez vite, je ne vois plus clair, il semble que le bateau est de côté. » Le pilote regarde et ment : « Non, madame, ce n’est pas leur bateau », mais ayant vu le canot chaviré, il court en toute hâte avec ses camarades. Mais il est trop tard. Lorsqu’on apporte quatre cadavres à Madame Vacquerie, sur ce même escalier d’où ils étaient partis, trois heures auparavant, elle ne veut pas les croire morts, mais tous les soins sont inutiles. Léopoldine n’avait que dix-neuf ans et son mari en avait vingt-six, l'oncle Pierre, soixante-deux et le cousin Arthur, à peine onze.
La mort de Léopoldine impressionnera beaucoup sa jeune sœur Adèle âgée de 13 ans, au point d'ébranler la santé psychique de l'adolescente.
Léopoldine Hugo repose au cimetière de Villequier, dans le même cercueil que Charles Vacquerie.
Le poète découvre le sort tragique de sa fille préférée à Rochefort, à son retour d'Espagne le 9 septembre 1843, en lisant dans Le Siècle le récit du drame par le journaliste Alphonse Karr. « On m'apporte de la bière et un journal, Le Siècle. J'ai lu. C'est ainsi que j'ai appris que la moitié de ma vie et de mon cœur était morte » écrira-t-il plus tard.
Ce drame va bouleverser la vie de Victor Hugo, chef de file de l'école romantique, pair de France, gloire du royaume. Mesurant la fragilité de la vie et du bonheur, l'écrivain mûrit très vite. Pendant plusieurs années, il s'abstient de toute publication. Il s'initie aussi au spiritisme et aux tables tournantes. Enfin, ce pilier de l'ordre monarchique et bourgeois se mue en héraut des humbles et de la République.