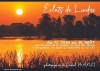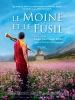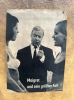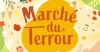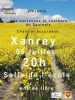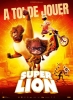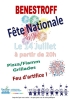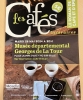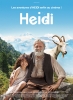L'expression est utilisée pour décrire la trêve hivernale, en politique, traditionnellement suivie en France, depuis 1875, par l'Assemblée nationale et le Sénat). L'expression « trêve des confiseurs » est également utilisée pour désigner l'accalmie traditionnelle de fin d'année sur les marchés boursiers, ainsi que la pause sur les terrains de football (essentiellement pour des raisons météorologiques).
L'expression est utilisée pour décrire la trêve hivernale, en politique, traditionnellement suivie en France, depuis 1875, par l'Assemblée nationale et le Sénat). L'expression « trêve des confiseurs » est également utilisée pour désigner l'accalmie traditionnelle de fin d'année sur les marchés boursiers, ainsi que la pause sur les terrains de football (essentiellement pour des raisons météorologiques).
Donc, cette semaine le Républicain Lorrain n'a pas édité sa carte des festivités du Saulnois et Une semaine en Lorraine n'a pas produit sa vidéo.
Alors, attardons-nous un peu sur cette expression après avoir consulté le calendrier du site pour préparer nos sorties du week-end..
Elle est construite ainsi car cette période hivernale des fêtes est traditionnellement propice aux plaisirs de la table et plus particulièrement aux confiseries.
La trêve des confiseurs a lieu la semaine entre Noël et le jour de l'an. C'est tout simplement une période de calme commercial sauf pour les confiseurs dont l'activité est au summum.
L'origine viendrait du milieu du XIIIème siècle lors d'une guerre pendant laquelle le roi Saint Louis imposa une trève en cette période de l'année. Ensuite, le mouvement prit plus d'ampleur quand le parlement de la IVème république cessa son activité en cette période de l'année et dès l'instauration des congés payés, les salariés prirent l'habitude de les demander à cette date car les entreprises fonctionnaient au ralenti sauf les confiseurs qui étaient au contraire obligés de travailler plus en cette période.
L'expression est apparue en France vers 1875, à l'occasion des vifs débats, à la Chambre, entre monarchistes, bonapartistes et républicains, sur la future constitution de la Troisième République. En décembre 1874, « d'un commun accord, tous les groupes de la Chambre jugèrent que l'époque du renouvellement de l'année était peu propice à des débats passionnés. À cette occasion la presse satirique imagine le mot de « trêve des confiseurs » » (Jules Lermina, Fondation de la République française, 1882).
« Aux approches de Noël, par une sorte d'accord entre les parlementaires, on ne soulève pas de questions irritantes, qui, troublant l'esprit public, nuiraient aux affaires. Et même, afin de mieux vivre en paix, on se sépare, on se donne des vacances. Donc, point d'aigres propos et pendant cette accalmie, les marchands de sucreries, de gâteaux, de friandises, font, tout doucement, leur petit commerce. Les confiseurs jubilent, profitant de la suspension des hostilités à la Chambre, et cette tranquillité dont ils bénéficient s'est appelée la trêve des confiseurs. »
En 1892, on trouve l'expression sous la plume de Paul Verlaine dans une correspondance :
« Mon cher Vanier, maintenant que voici passée « la trêve des confiseurs », recausons un peu... pas d'argent. Ah, c'est bien, çà, hein ? mais patience ! Attendez. En attendant me voilà bon prince, et parlons littérature. »
(Paul Verlaine, Correspondance de Paul Verlaine, publiée sur les manuscrits originaux. Volume 2, Adolphe van Bever, A. Messein éditeur, 1923)
Parfois cette trêve était appelée la trêve de Noël comme lors de la période de Noël 1914 de la Première Guerre mondiale, lorsque les soldats britanniques qui tenaient les tranchées autour de la ville belge d'Ypres fraternisèrent, pour une nuit, avec les soldats allemands.
L'expression se souvient peut-être de la trêve de Dieu, confirmée en France par le roi Saint Louis vers 12453 : l'Église catholique romaine ordonnait que les combats guerriers soient arrêtés pendant la période de l'Avent à Noël4.