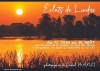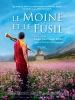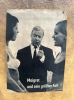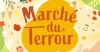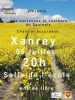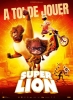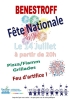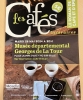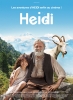Aujourd'hui 12 janvier 2017, réunion de crise à l'Elysée sur l'épidémie de grippe au lendemain de propos alarmants de Marisol Touraine évoquant un bilan "probablement lourd" en perspective, a-t-on appris de la présidence.
Aujourd'hui 12 janvier 2017, réunion de crise à l'Elysée sur l'épidémie de grippe au lendemain de propos alarmants de Marisol Touraine évoquant un bilan "probablement lourd" en perspective, a-t-on appris de la présidence.
En quatre semaines, 784.000 personnes ont consulté un médecin pour une grippe, d'après le réseau de surveillance Sentinelles-Inserm. Et depuis le 1er novembre, 52 personnes sont décédées en réanimation à l'hôpital, selon Santé publique France.
Affolement ou réminiscence de l'épidémie qui a sévi dans le monde il y a près de 100 ans ?
La grippe de 1918, aussi connue sous le nom de « grippe espagnole », est due à une souche (H1N1) particulièrement virulente et contagieuse de grippe qui s'est répandue en pandémie de 1918 à 1919. Cette pandémie a fait 50 millions de morts selon l'Institut Pasteur, et jusqu'à 100 millions selon certaines réévaluations récentes. Elle serait la pandémie la plus mortelle de l'histoire dans un laps de temps aussi court, devant les 34 millions de morts (estimation) de la peste noire.
Apparemment originaire de Chine, ce virus serait passé, selon des hypothèses désormais controversées, du canard au porc puis à l'humain, ou selon une hypothèse également controversée directement de l'oiseau à l'humain. Il a gagné rapidement les États-Unis, où le virus aurait muté pour devenir plus mortel. Cette nouvelle souche est trente fois plus mortelle que les grippes communes avec 3 % des malades. Elle devint une pandémie, lorsqu'elle passa des États-Unis à l'Europe.
Elle fit environ 408 000 morts en France, mais la censure de guerre en limita l'écho, les journaux annonçant une nouvelle épidémie en Espagne, pays neutre et donc moins censuré, alors que l'épidémie faisait déjà ses ravages en France. Elle se déroula essentiellement durant l'hiver 1918-1919, avec 1 milliard de malades dans le monde, et 20 à 40 millions de morts, selon de premières estimations très imprécises faute de statistiques établies à l'époque. Au début du XXIe siècle, le maximum de la fourchette reste imprécis mais a été porté à 50-100 millions, après intégration des évaluations rétrospectives concernant les pays asiatiques, africains et sud-américains.
On estime que 50 % de la population mondiale fut contaminée (soit à l'époque 1 milliard d'habitants), 60 à 100 millions de personnes en périrent, avec un consensus autour de 60 millions de morts. Un article dans le Lancet en 2006, réalisé par des chercheurs qui ont étudié les registres de décès de 27 pays, montre que la mortalité due à cette grippe varie d'un facteur 30 selon les régions et est corrélée au revenu économique moyen par habitant : à 10 % de revenu moyen en plus par habitant correspond une baisse de 10 % de la mortalité (corrélation linéaire inversement proportionnelle). Le lien entre la mortalité de cette épidémie et la pauvreté est ainsi établi.
Cette grippe se caractérise d'abord par une très forte contagiosité : une personne sur deux contaminée. Elle se caractérise ensuite par une période d'incubation de 2 à 3 jours, suivie de 3 à 5 jours de symptômes : fièvre, affaiblissement des défenses immunitaires, qui finalement permettent l'apparition de complications normalement bénignes, mais ici mortelles dans 3 % des cas, soit 20 fois plus que les grippes « normales ». Elle ne fait cependant qu'affaiblir les malades, qui meurent des complications qui en découlent. Sans antibiotiques, ces complications ne purent pas être freinées.
La mortalité importante était due à une surinfection bronchique bactérienne, mais aussi à une pneumonie due au virus. L'atteinte préférentielle d'adultes jeunes pourrait peut-être s'expliquer par une relative immunisation des personnes plus âgées ayant été contaminées auparavant par un virus proche.
Les caractéristiques génétiques du virus ont pu être établies grâce à la conservation de tissus prélevés au cours d'autopsies récentes sur des cadavres inuits et norvégiens conservés dans le pergélisol (sol gelé des pays nordiques). Ce virus est une grippe H1N1 dont l'origine aviaire est fortement suspectée à la suite de l'identification en 1999 de la séquence complète des 1701 nucléotides du gène de l'hémagglutinine. Le virus est à l'origine de trois vagues principales :
- « virus père », souche inconnue : virus de grippe source, à forte contagiosité mais à virulence normale (mortalité de 0,1 %) qui, par mutation, donna le virus de la grippe espagnole. Le virus père ne fut identifié qu'en février par le médecin généraliste Loring Miner (de) du Comté de Haskell et suivi rigoureusement qu'à partir d'avril (après une épidémie touchant des milliers de soldats américains dans le Camp Fuston en mars), et jusqu'à juin 1918 (gagnant l'Europe lors du débarquement des troupes américaines à Brest, Bordeaux, Étaples), alors qu'il sévit probablement dès l'hiver 1917-1918 en Chine ;
- virus de la grippe espagnole, souche H1N1 se révélant être de même origine que le « virus père » qui a muté, les personnes atteintes lors de la première vague sont en effet immunisées lors de la deuxième : virus à forte virulence apparemment apparu aux États-Unis (attesté à la parade de Philadelphie6) et ayant finalement tué plus de 21 millions de personnes à travers le monde ; cette appellation inclut généralement aussi son « virus père ». Cette version plus létale (mortalité de 2 à 4 %) sévit en deux vagues meurtrières, l'une de mi-septembre à décembre 1918, l'autre de février à mai 1919. Tous les continents et toutes les populations ont été gravement touchés.
Grâce au travail de plusieurs équipes de chercheurs, notamment celle du Dr Jeffery Taubenberger, de l'Institut de pathologie des forces armées américaines, il a été en 2004 possible pour la première fois de synthétiser artificiellement le virus de 1918.
Il est aussi à noter, vu le cycle de réapparition des épidémies de grippe mortelle s'espaçant, au maximum constaté, de 39 ans, la dernière datant de 1968, l'OMS prévoyait « statistiquement » l'apparition d'une pandémie de grippe mortelle d'ici 2010 à 2015. Voilà pourquoi, depuis quelques années, un certain nombre d'études sont soudainement consacrées au virus de la grippe espagnole, certaines visant à en récupérer des souches intactes, tangiblement étudiables, pour permettre l'édification de défenses adéquates. Cela explique aussi la mobilisation rapide et énorme, en 2009, pour le début de pandémie de grippe porcine, dite grippe A. La grippe aviaire (H5N1) cristallise ainsi non seulement des risques médicaux tangibles mais aussi des peurs bien plus abstraites.
En France, les patients et les soignants ne se vaccinent pas assez", a regretté Marisol Touraine en sortant de la réunion à l'Elysée sur l'épidémie. "Le débat sur la vaccination viendra en temps et en heure. Je regrette la défiance qui existe dans notre pays à l'égard de la vaccination", a-t-elle ajouté.