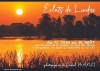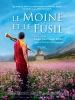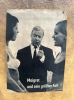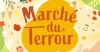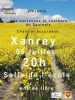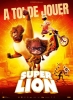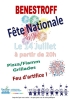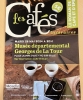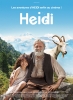Comme nous l'avons vu hier sur ce site, la méthanisation avec injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel est une solution pour l'élimination des effluents de l'élevage.
Comme nous l'avons vu hier sur ce site, la méthanisation avec injection de biogaz dans le réseau de gaz naturel est une solution pour l'élimination des effluents de l'élevage.
GRdF recense à ce jour 408 projets à l’étude. Mais il est très difficile de prévoir leur date de raccordement, un projet mettant en moyenne quatre ans pour
se concrétiser.
Les deux tiers des demandes sont d’origine agricole (en association souvent avec des collectivités locales) et agroalimentaire. Un tiers concerne des projets plus importants liés à des Step, des ordures ménagères, ou des décharges, ce qui n'est pas envisagé pour le moment par l'unité de Haraucourt-Marsal.
Leur débit est très variable, mais la moyenne est de 220 Nm³/h, soit 20 GWh par an. Bien en deçà de l’Allemagne comme le fait remarquer Valérie Bosso, chef de projet biométhane à GRdF.
Le modèle allemand est très critiqué, car la méthanisation utilise surtout le maïs plutôt que les déchets, or cette plante demande beaucoup d’eau, d’engrais et de désherbant.
Pour éviter cet écueil en France GRdF pense ajuster les tarifs selon les intrants. Certes, le maïs améliore le rendement, mais les graisses issues de l’agroalimentaire aussi » met en avant la chef de projet. Source La gazette des Communes à consulter en cliquant ici
Il faut noter d'autre part que la méthanisation ne permet pas le traitement de l’azote. Lorsque 1 kg d’azote entre dans le méthaniseur, il en ressort 1 kg. Même si sa forme a changé (digestat).Le risque pour les régions d’élevage est d’importer encore plus d’azote sur un territoire en zone vulnérable pour alimenter les méthaniseurs. Il faut éviter de tomber dans le piège allemand, où au final, le bilan est néfaste pour l’environnement, comme ce fût le cas pour les agrocarburants de première génération. L’Ademe prépare justement un bilan global de la filière. Histoire de vérifier que ce n’est pas une « fausse bonne idée » !
Mais ce qui fait essentiellement débat actuellement sur le secteur, c'est la localisation de cette unité de production de biogaz à proximité d'un lieu touristique, Marsal.
Celle-ci devrait se faire à moins de 600m de l'entrée du village, devant les vestiges des remparts de Vauban, remparts qui valent à Marsal d'appartenir au Réseau des Villes Fortifiées de la Grande Région.
Centre touristique avec le Musée départemental du sel, la collégiale Saint Léger récemment restaurée, la Mare Salée aménagée pour sa protection, un village où de nombreuses bâtisses rappellent son passé militaire et un site archéologique incomparable exploité par le musée de Saint Germain en Laye.
À moins d’une heure de voiture de Nancy ou de Metz par Château-Salins des visites sont organisées pour découvrir les richesses du village et de ses remparts dont les vestiges conservés datent pour la plupart du XVIIe et du début du XVIIIe siècle (les forts d'Haraucourt et d'Orléans seront ajoutés au milieu du XIXe siècle pour défendre les flancs nord et sud de la place).
Après la prise de Marsal en 1870, les fortifications ont été démantelées (notamment les pierres de parement). Néanmoins les murailles sont encore relativement bien conservées sur tout le flanc nord de la cité (la courtine entre les bastions Vieille-ville et romain présente encore des pierres de parement) et une partie de son flanc sud (poterne).
Le bastion dit Romain est quant à lui particulier, il est fait de briques (sans doute un vestige de l'époque lorraine).
Aujourd'hui, la conservation des vestiges de fortifications est menacée par la végétation, et notamment des arbres qu'on laisse pousser directement sur les murs, leurs racines poussant les structures en place. Aussi, le bastion romain est-il particulièrement fragilisé (des amas de briques chutent encore et toujours).
Espérons une prise de conscience pour sauvegarder ces fortifications pluriséculaires qui font la fierté des locaux, et le plaisir des visiteurs !
Vous pouvez vous reporter à la carte de Géoportail et calculer les distances sur la vue aérienne en cliquant ici
Il est à noter que les ABF (Bâtiments de France) ont accepté la construction de l'unité sous différentes conditions acceptées par les porteurs du projet.