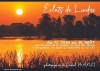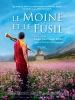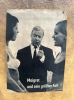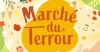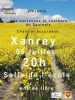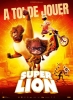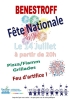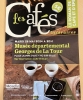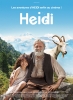Une initiative internationale pour que le 25 juin soit reconnue officiellement comme la journée mondiale du vitiligo par les Nations Unies, a été lancée par le biais du site 25june.org. Elle vise à recueillir 500.000 signatures pour une pétition qui sera portée à la connaissance du Secrétaire Général des Nations Unies.
Une initiative internationale pour que le 25 juin soit reconnue officiellement comme la journée mondiale du vitiligo par les Nations Unies, a été lancée par le biais du site 25june.org. Elle vise à recueillir 500.000 signatures pour une pétition qui sera portée à la connaissance du Secrétaire Général des Nations Unies.
Le vitiligo n'est pas une maladie infectieuse, ni contagieuse mais peut être transmis par hérédité, on estime d'ailleurs ce risque à 30 %. Une mutation sur le gène NALP1 (pour « NACHT leucine-rich-repeat protein 1 ») a été identifiée comme corrélée au risque de développer un vitiligo.
C'est donc une maladie de la peau responsable notamment du blanchissement de la peau de Michael Jackson.
Site à visiter : www.afvitiligo.com/
Le mécanisme n'en est pas clairement établi :
- théorie nerveuse : l'accumulation de neuromédiateurs ou leur libération massive lors d'un stress psychoaffectif pourraient favoriser la disparition des mélanocytes ;
- théorie auto-immune : c’est l’hypothèse la plus tangible car un pourcentage significatif de patients atteints de vitiligo souffrent en plus d’une autre maladie auto-immune, par exemple une thyroïdite de Hashimoto, une maladie de Basedow, une maladie d’Addison, un diabète de type 1 ;
- théorie toxique : accumulation de radicaux libres qui sont nocifs pour les mélanocytes.
La dépigmentation que provoque cette maladie résulte de la perte des mélanocytes (cellules produisant la mélanine).
Les zones atteintes n'étant plus pigmentées, elles sont particulièrement sensibles aux rayons ultraviolets (la mélanine ayant habituellement pour rôle de protéger du soleil grâce au bronzage). Dans certains cas, on peut aussi constater une concentration de mélanine (zone plus sombre) aux abords de la zone atteinte.
Ce défaut pigmentaire se manifeste principalement sur le visage, les extrémités, les articulations et les zones de frictions : phénomène de Koebner.
Diagnostic
Il repose essentiellement sur la constatation des lésions caractéristiques sur la peau. Il existe deux formes principales : la forme « généralisée » se caractérise par des plaques plus ou moins symétriques par rapport à l'axe médian du corps et représente presque 90 % des cas. La forme segmentaire est un peu plus fréquente chez l'enfant, surtout au niveau du visage, avec une progression plus rapide.
Dans les stades tardifs, une dépigmentation des poils ou des cheveux peut être vue.
Cette maladie ne provoque pas de douleurs physiques mais peut poser des contrariétés d'ordre esthétique ou pour la vie sociale
Traitement médical
- irradiation par des ultraviolets B, essentiellement pour les formes généralisées ;
- psoralène associé à des ultraviolets A (PUVA-thérapie), cependant moins efficace que le traitement par ultraviolets B ;
- les corticostéroïdes en pommades ou en crèmes sont d'une bonne et rapide efficacité mais les résultats sont inconstants dans le temps ;
- les inhibiteurs de la calcineurine (ex. : tacrolimus) en pommade, peuvent être employés, de préférence sous un pansement ;
- traitement au laser excimer (résultats probants sur vitiligo stabilisé) ;
- l'acide para-amino-benzoïque (anciennement nommée vitamine B10) aurait une action bénéfique sur le long terme et est utilisée pour son traitement.
Si les plaques sont de taille modérée, elles peuvent être artificiellement masquées par un maquillage. Certains autobronzants spécialement conçus pour le vitiligo sont la solution simple, rapide et efficace pour masquer les zones dépigmentées.
Traitement chirurgical
Il est recommandé quand le traitement médical est inefficace et consiste en des transplantations de mélanocytes. Le vitiligo doit être cliniquement stable depuis au moins un an afin d'envisager ce type de traitement (sinon il y a risque élevé de récidive).
Cette transplantation peut se faire de plusieurs manières :
- greffe de peau ultra mince. Une surface identique à la surface à traiter doit être prélevée sur une partie du corps non touchée par la maladie ;
- microgreffe (punch graf en anglais). Plusieurs séances sont à prévoir, avec un risque de cicatrice ;
- culture de mélanocytes, préalablement prélevés sur un échantillon de peau puis cultivé en laboratoire. Cette technique est peu répandue car délicate et chère ;
- suspension fraîche de cellules épidermiques (kératinocytes et mélanocytes) préparée à partir d'un échantillon de peau mince. La surface traitée peut être plusieurs dizaine de fois la taille de l'échantillon prélevé. Cette technique nécessite traditionnellement un laboratoire mais un dispositif médical est depuis peu sur le marché et évite le recours au laboratoire (ReCell de la société Clinical cell Culture).
Dans tous les cas la procédure est similaire :
- prélèvement de l'échantillon sur une zone saine ;
- retrait de la couche supérieure de l'épiderme sur la zone à traiter (dermabrasion mécanique ou laser) sous anesthésie locale en général ;
- application de la greffe ou de la suspension ;
- pansement pendant une semaine.
L'épiderme est reconstruit en une semaine mais les mélanocytes demandent 4 à 6 semaines pour produire de la mélanine qui restaurera la pigmentation. Des séances d'ultraviolets peuvent être prescrites, surtout sur les peaux claires, pour stimuler les mélanocytes nouvellement greffés.