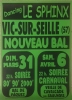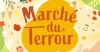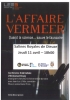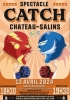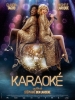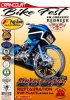La catastrophe de Courrières est la plus importante catastrophe minière d'Europe. Elle a lieu entre Courrières et Lens, le samedi 10 mars 1906 et a fait officiellement 1 099 morts. Elle tire son nom de la Compagnie des mines de Courrières qui exploite alors le gisement de charbon du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais dans le Pas-de-Calais. La Compagnie fournit alors 7 % de la production nationale de charbon.
La catastrophe de Courrières est la plus importante catastrophe minière d'Europe. Elle a lieu entre Courrières et Lens, le samedi 10 mars 1906 et a fait officiellement 1 099 morts. Elle tire son nom de la Compagnie des mines de Courrières qui exploite alors le gisement de charbon du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais dans le Pas-de-Calais. La Compagnie fournit alors 7 % de la production nationale de charbon.
Le point de départ de cette catastrophe est l'explosion d'une poche de grisou dans le chantier Lecoeuvre probablement déclenché l'utilisation de lampes à feu nu. (À partir de cette époque, les lampes à feu nu sont bannies au profit des lampes dites de sûreté, les lampes Davy).. La présence de ce gaz avait été suspectée quelques jours plus tôt par des mineurs de fond mais la compagnie n'avait pas tenu compte de leurs avertissements. Le coup de grisou a ensuite soulevé la poussière de charbon, cette dernière, beaucoup plus explosive que le grisou, s'est mise en auto-combustion et la flamme a parcouru 110 kilomètres de galeries en moins de deux minutes. Le coup de grisou a donc été immédiatement suivi par un coup de poussier beaucoup plus dévastateur et meurtrier.
Le 10 mars, à six heures du matin, 1 664 mineurs et galibots (âgés de 14 à 15 ans), étaient déjà descendus dans les fosses 2, 3, 4 et 10 dont les zones de travail étaient situées à une profondeur variant entre 330 et 340 mètres. À 6 h 30, des employés aperçoivent une fumée noire sortant de la porte du moulinage de la fosse n° 3. Quelques minutes plus tard, une déflagration ébranle le puits n° 4. La chaleur causée par l'explosion a transformé les galeries en une véritable fournaise, et la déflagration associée a tout balayé sur une distance de 110 kilomètres.
Le choc a été si fort que les cages ne peuvent plus circuler dans le puits de la fosse no 3 et que des débris et des chevaux ont été projetés à une hauteur de dix mètres sur le carreau de la fosse.
Trois jours après l'explosion, les recherches pour retrouver les survivants sont abandonnées et une partie de la mine est condamnée, pour étouffer l'incendie et préserver le gisement. Cette gestion de la crise par la compagnie minière a été particulièrement mal vécue par les mineurs et par leurs familles.
Le sauvetage des installations avant celui des mineurs
Dans la journée du 11 mars, l'ingénieur en chef a voulu réunir une table ronde et interroger les survivants. Le but était de faire un point précis sur la situation. En revanche, les ingénieurs et les mineurs ne voulaient pas perdre de temps en bavardages pendant que leurs camarades mouraient au fond. Cette opposition eut sa part de responsabilité dans l'ampleur des pertes humaines car les ingénieurs envoyés par l'État, piqués dans leur orgueil, adoptèrent des mesures qui furent parfois aberrantes. Ils considéraient qu'il n'était pas possible de désobstruer le puits n°3, dont le cuvelage et les installations étaient fortement abimés à la profondeur de 160 mètres. De plus, toutes les recherches qui avaient été menées à partir des puits n°2 et 4 démontraient qu'il ne restait aucun survivant dans les quartiers du n°3, les ingénieurs de l'État décidèrent de fermer le puits n°3, d'actionner les ventilateurs afin de le transformer en puits de sortie d'air.
La polémique vient du fait que le grand nombre de victimes soit dû en grande partie à l'obstination de la compagnie minière à poursuivre l'exploitation dans les autres puits alors qu'au fond un incendie n'avait pas encore été complètement maîtrisé et que des fumées et gaz toxiques remplissaient encore les galeries. Mais il y aurait aussi eu probablement moins de morts si les recherches n'avaient pas été arrêtées dès le troisième jour et si une partie de la mine n'avait pas été murée, sur ordre de l'ingénieur général Delafond, pour étouffer l'incendie et préserver le gisement.
Un miracle, 20 jours après la catastrophe : treize rescapés
 Le 30 mars, soit vingt jours après l'explosion, treize rescapés réussirent à retrouver le puits par leurs propres moyens après avoir erré dans le noir total sur des kilomètres. Ils furent aperçus par un ouvrier sauveteur à proximité de l'accrochage dans le puits n° 2. Une équipe descendit et trouva 13 hommes faisant des gestes désespérés dans l'obscurité. Les mineurs ont raconté avoir mangé le peu qu'ils trouvaient, y compris de l'avoine et un cheval qu'ils ont abattu à coups de pic.
Le 30 mars, soit vingt jours après l'explosion, treize rescapés réussirent à retrouver le puits par leurs propres moyens après avoir erré dans le noir total sur des kilomètres. Ils furent aperçus par un ouvrier sauveteur à proximité de l'accrochage dans le puits n° 2. Une équipe descendit et trouva 13 hommes faisant des gestes désespérés dans l'obscurité. Les mineurs ont raconté avoir mangé le peu qu'ils trouvaient, y compris de l'avoine et un cheval qu'ils ont abattu à coups de pic.
Les treize rescapés sont Léon Boursier (19 ans), Louis Castel (22 ans), Honoré Couplet (20 ans), César Danglot (27 ans), Albert Dubois (17 ans), Élie Lefebvre (38 ans), Victor Martin (14 ans), Henri Neny (39 ans), Romain Noiret (33 ans), Charles Pruvost (40 ans) et son fils Anselme Pruvost (15 ans), Vanoudenhove Léon (18 ans) et Henri Wattiez (27 ans).
Le dernier survivant des treize rescapés de la catastrophe était Honoré Couplet. Il est décédé en 1977 à l'âge de 91 ans. Parmi les rescapés deux d'entre eux continuèrent à travailler à la mine durant quarante-deux et quarante-cinq ans, étant donné que c'était leur seul gagne-pain.
L'impensable, 24 jours après la catastrophe : Berthou, le dernier survivant.
 Un quatorzième survivant, Auguste Berthou, mineur à la fosse n° 4 de Sallaumines, fut retrouvé le 4 avril, grâce aux secouristes allemands qui avaient apporté des appareils respiratoires qui faisaient cruellement défaut aux compagnies minières locales. Il avait erré durant 24 jours à plus de 300 mètres de profondeur, dans le noir complet et les fumées toxiques. Il fut remonté par le puits n° 4.
Un quatorzième survivant, Auguste Berthou, mineur à la fosse n° 4 de Sallaumines, fut retrouvé le 4 avril, grâce aux secouristes allemands qui avaient apporté des appareils respiratoires qui faisaient cruellement défaut aux compagnies minières locales. Il avait erré durant 24 jours à plus de 300 mètres de profondeur, dans le noir complet et les fumées toxiques. Il fut remonté par le puits n° 4.
La catastrophe provoque une crise politique et un mouvement social qui débouchent sur l'instauration du repos hebdomadaire.
L'émotion qui s'ensuivit, et la polémique sur la gestion des secours, sont à l'origine d'un vaste mouvement de grève. Le 13 mars, lors des obsèques des premières victimes, à la fosse commune de Billy-Montigny, sous une tempête de neige, en présence de 15 000 personnes, le directeur de la compagnie est accueilli par des huées et des « assassins ! » et doit rapidement partir ; la foule scande « Vive la révolution ! Vive la grève ! ». Le lendemain, les mineurs refusent de redescendre au fond. Les syndicats appellent à une grève qui s'étend aux puits environnants. Le mouvement s'étend à tous les bassins miniers français et se développe jusque dans le Borinage, en Belgique.
Le 16 mars, 25 000 ouvriers sont en grève, chiffre qui monte même à 60 000. Les incidents se multiplient entre grévistes et non-grévistes, mais aussi entre les partisans du « Vieux Syndicat » mené par Émile Basly et le « Jeune Syndicat », affilié à la CGT et mené par Benoît Broutchoux.
Face aux mineurs en colère, Georges Clemenceau, alors ministre de l'Intérieur, mobilise 30 000 gendarmes et soldats et envoie treize trains de renforts militaires. De nombreuses arrestations auront eu lieu.
La grève se durcit et un officier de l'armée est tué le 23 avril. À la fin du mois, malgré la répression et le manque d'argent des familles des mineurs, le patronat concède des augmentations de salaires. Le travail reprend début mai.
Après la catastrophe, la langue française s'est enrichie d'un mot nouveau d'origine picarde : rescapé, largement repris dans la presse, et qui supplanta réchappé.